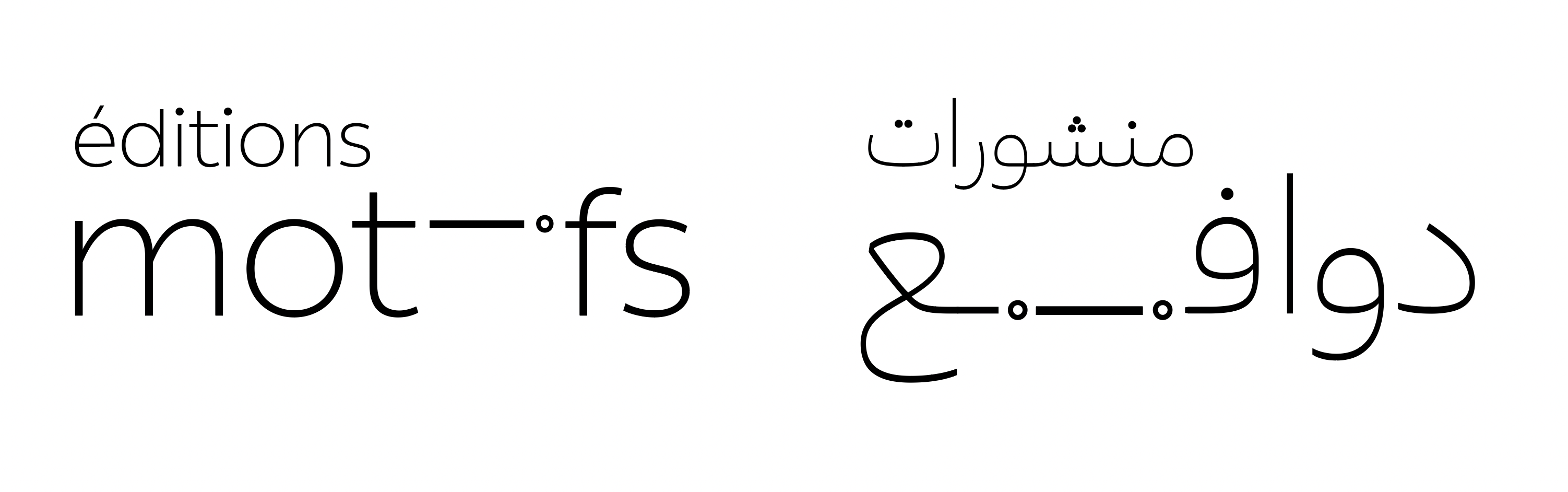Michèle Audin
Entretien réalisé par Lamine Ammar-Khodja
(Entretien publié dans le numéro 6 de la revue de critique littéraire Fassl, en novembre 2023)
C’est en flânant dans une bibliothèque à Paris que pour la première fois j’ai rencontré un livre de Michèle Audin. Ce qui m’a attiré c’est le nom : Audin. Un nom que j’entendais régulièrement à Alger en arrivant au croisement de la rue Didouche Mourad et du boulevard Mohammed V…Après avoir lu et aimé ce livre, j’ai découvert que Michèle Audin en avait écrit huit en tout, dont Une vie brève, son premier, à propos de son père, Maurice Audin, le même qui a donné son nom à la place située au croisement…
Publiés en l’espace de dix ans (entre 2013 et 2023), ces huit livres laissent entrevoir des thématiques récurrentes qui ont trait à la disparition, l’oubli donc la mémoire, la politique, les mathématiques, la littérature, la Commune de Paris[1], l’Histoire et plus particulièrement celle des femmes. Souvent, ces thématiques s’entrecroisent comme dans Mademoiselle Haas par exemple, un livre de nouvelles qui se déroulent pendant la montée du fascisme (entre ’34 et ’41) et dont les héroïnes qui portent toutes le nom de Haas sont « bibliothécaire, concierge, cuisinière, coiffeuse, première main flou, fraiseuse, infirmière, écrivaine, femme de chambre, institutrice, journaliste, femme de ménage, chef de travaux, ouvrière métallurgiste, libraire, pianiste, physicienne, ourdisseuse, sage-femme, vendeuse… »
Parmi elles, Albertine, une femme de ménage dont le corps souffre, qui doit travailler dans plusieurs maisons, et dont le mari est violent et alcoolique. Son histoire nous est racontée en parallèle à un flux d’informations sur l’actualité de son époque. Or voilà que parmi ces informations qui défilent, on apprend dans un entrefilet de quelques mots que « rentrant chez lui avec son kil de rouge bien entamé, un chômeur de la rue du Chemin-Vert recommença à battre sa femme » : l’histoire d’Albertine donc.
Ce souci de vouloir mettre un doigt sur un entrefilet d’actualité qui passe trop vite, et de le contrebalancer en nous racontant l’histoire tragique qui se cache derrière ces quelques mots, répond à un souci éthique d’être du côté des oubliés de l’Histoire, de celles et ceux qui n’ont justement pas d’histoire. Ainsi, si l’on met de côté les mathématiciens, on retrouvera au fil de la lecture des personnages comme des ouvriers, des communards, des femmes de toutes conditions, des disparus…
Huit livres pour l’instant, même si ce n’est pas tout à fait vrai, car ce serait sans compter ceux qui ont été publiés avant Une vie brève, en plus des articles, contributions dans des journaux, blogs et sites divers, accompagnés depuis quelques années d’un travail d’édition.
Rien que sur la Commune de Paris, on lui doit :
– Un blog contenant une somme de documents, articles, photos, recensions de livres, réflexions, très régulièrement alimenté, et qu’on peut consulter gratuitement à cette adresse : macommunedeparis.com
– Deux romans : Comme une rivière bleue. Paris 1871 et Josée Meunier, 19 rue des Juifs ».
– Trois travaux d’édition ou réédition : les écrits d’Eugène Varlin (ouvrier relieur), d’Alix Payen (une ambulancière) et ceux de Camille Pelletan (historien, journaliste et homme politique).
– Un livre de décompte sur la Semaine sanglante : « La Semaine sanglante : Mai 1871, légendes et comptes », où l’utilisation des nombres ne relève pas d’un chiffrage mathématique froid et macabre, mais encore une fois d’un souci éthique : « Il ne s’agit pas, comme l’a dit en son temps le journaliste radical Camille Pelletan, de se jeter des crimes et des cadavres à la tête, mais de considérer les êtres humains qu’ont été ces cadavres avec respect, de ne pas les laisser disparaître encore une fois – ce qui oblige aussi à se souvenir de ce qu’ils ont été, de ce qu’ils ont fait. »
Toute cette énergie, on la retrouve aussi en la personne de Michèle Audin. Pour cette habituée des archives, rien d’étonnant à ce que ce soit dans le jardin de la Bibliothèque Historique de la Ville de Paris, que j’ai pu m’entretenir avec elle sur son parcours, ces travaux littéraires et autres. Joviale, précise, dénuée de tout esprit de sérieux (c’est assez rare et agréable pour être souligné), elle a joué le jeu jusqu’au bout, en répondant à toutes les questions que j’ai pu lui poser (et il y en avait beaucoup). Qu’elle en soit chaleureusement remerciée. Ainsi, peut-être, en plus d’être situé à un croisement de rues, le nom d’Audin pourra-t-il aussi résonner comme un objet littéraire.

Une vie brève est votre premier livre de facture littéraire, mais ce n’est pas le premier livre que vous avez publié. En guise d’introduction, pourriez-vous résumer votre parcours d’avant d’y arriver.
J’ai été formée comme mathématicienne, j’ai donc publié des articles mais aussi des livres de recherche mathématique. Et d’ailleurs aussi un livre de géométrie pour les étudiants qui préparent l’agrégation de mathématiques et qui a donc été utilisé par beaucoup de profs de maths. C’est mon best-seller.
Et puis, j’ai aussi écrit quelques livres liés à l’histoire des mathématiciens. Un sur la mathématicienne russe, Sofia Kovalevskaïa qui était une mathématicienne de la deuxième moitié du XIXème siècle. Quelqu’un qui a eu une vie très intéressante, très brève. C’est un livre où il y a des mathématiques, de l’ histoire, un peu de littérature parce qu’elle écrivait aussi des romans.
Et puis j’ai aussi écrit des livres sur les mathématiciens français de la première moitié du vingtième siècle, mais je ne le fais plus. D’abord, c’est assez pénible parce qu’il n’y a que des hommes. Et puis un des mathématiciens sur lequel j’ai travaillé a été collaborateur pendant la deuxième guerre mondiale, mais la famille ne veut pas qu’on en parle. Ça interdit, par exemple, de publier sa correspondance.
De façon complémentaire, j’ai aussi écrit un livre sur Jacques Feldbau qui est un mathématicien strasbourgeois, né en 1914 et mort en 1945. Rien que les dates… C’était un jeune mathématicien qui pratiquait le genre de mathématiques que j’ai moi aussi pratiqué. Il était juif, il a été déporté, il est mort en déportation, après Auschwitz. J’ai découvert, à son propos, comment un certain nombre de scientifiques français avaient empêché leurs collègues juifs de publier pendant l’occupation allemande.
Vous écrivez ces livres parce que vous êtes intéressée par l’histoire des sciences ?
Plutôt par l’histoire des mathématiciens que par celle des mathématiques.
Leurs parcours…
Pas seulement. Par exemple, pendant la première guerre mondiale, il y a un mathématicien, Gaston Julia, qui est une « gueule cassée ». C’est un jeune homme qui reçoit une balle en pleine figure. Il a vécu une vie d’enfer avec ça. Mais, comme les mathématiciens qui avaient le pouvoir à ce moment-là avaient tous des fils qui avaient été tués à la guerre, il a été poussé par ces gens-là et ça a eu une influence sur l’histoire des mathématiques.
Vous avez été donc au croisement de l’histoire et des mathématiques.
Oui.
Vous aviez alors en tête des projets littéraires plus personnels ?
Oui, j’ai toujours écrit. Même mes livres de maths sont écrits.
Et en 2009, vous rejoignez l’Oulipo.
Oui. Il y avait ce livre sur Sofia Kovalevskaïa. Franchement, quand j’ai écrit ce livre, je pensais que j’étais en train d’inventer un nouveau concept (rire) : il y a tout à la fois, des maths, de l’ histoire, des pastiches littéraires… j’étais très contente, je pensais que j’allais faire un grand succès (rire). Ça n’a pas très bien marché, surtout que l’éditeur avait très envie de faire le livre mais pas tellement de le vendre.
J’en avais envoyé un exemplaire au poète Jacques Roubaud qui est membre de l’Oulipo. J’ai été invitée à une réunion de l’Oulipo au cours de laquelle j’ai parlé de ce livre et quelques mois après, ils m’ont proposé de revenir pour toujours, alors j’ai dit oui.
Ça m’a été utile pour ma vie littéraire parce que ça m’a donné une certaine légitimité vis à vis de moi-même. Je me suis moins censurée sur ce que j’avais envie d’écrire. Et j’ai écrit.
Pourriez-vous décrire en quoi consistent les activités de l’Oulipo ?
C’est un groupe d’écrivains, mathématiciens, etc., qui fabrique et propose des «contraintes» pour écrire des textes littéraires. Des contraintes littérales (la plus célèbre est « écrire sans utiliser la lettre e »), mathématiques, grammaticales et autres. Souvent, en les utilisant eux-mêmes, mais toujours de façon publique, au sens où il n’y a pas de propriété de ces contraintes que tout le monde est libre d’utiliser. Et « nous » nous réunissons une fois par mois, depuis… novembre 1960.
Toujours avant Une vie brève, il y a un autre livre que vous avez écrit mais qui n’a pas été publié : Mai quai Conti.
Justement. Quand je suis arrivée à l’Oulipo, on m’a dit : « Il faut nous proposer des contraintes mathématiques ». Mais ils avaient déjà tout un arsenal de contraintes, principalement combinatoires, basées sur des permutations ou des décomptes de lettres, etc. Donc je me suis dit : « moi je suis géomètre, je vais leur proposer des contraintes géométriques » .
J’ai donc proposé de prendre une figure de géométrie illustrant un théorème et d’écrire un texte à partir de ça.
Par exemple, les points pourraient être des personnages. Le fait que trois points soient alignés signifie une relation entre les trois personnages concernés, etc.
J’ai donc fait ça avec un exemple assez compliqué, un théorème de Pascal. Voici : il y a une ellipse, et six points sur cette ellipse. J’ai décidé que l’ellipse représentait la salle de séance de l’Académie des sciences. Les six points étaient six des académiciens. D’autres points, obtenus à partir des six premiers, sont d’autres personnages. J’ai raconté une histoire avec ça.
J’avais envie d’écrire quelque chose où on parle de ce que font les mathématiciens mais de façon assez précise dans le temps. L’Académie des sciences, c’est très pratique : ils se réunissaient tous les lundis et un fascicule de leurs publications est consacré à chacun de ces lundis. Les théorèmes présentés, en particulier, ont ainsi des dates précises. Et la Commune de Paris c’est très bien aussi, parce que c’est court, enfin ça ne leur ferait peut-être pas très plaisir d’entendre ça, mais cela ne dure que dix semaines.
Et il est intéressant de savoir ce qu’a fait l’Académie des sciences pendant la Commune de Paris. Les académiciens qui sont là sont très peu nombreux. Beaucoup ont quitté Paris, ce sont des bourgeois, la plupart anti-communards. Mais ceux qui sont à Paris viennent tous les lundis parce qu’ils veulent affirmer que la science continue. Les communards, eux, ils veulent que la science soit pour le peuple, et en particulier, le Journal Officiel de la Commune envoie toutes les semaines un journaliste à l’Académie des sciences.
J’étais donc très contente d’écrire ça, ça m’a fait très plaisir. Mais aucun éditeur n’en a voulu (rire). On peut le lire en ligne. www.oulipo.net/fr/ mai-quai-conti
En réalité, je trouve plus intéressant d’écrire des livres que de m’occuper de les faire publier (rire).
Vous avez donc amené de nouvelles contraintes à l’Oulipo…
Oui. Mais, comme je l’ai dit, les contraintes oulipiennes, les prend qui veut. Je ne pense pas que beaucoup de monde ait utilisé les contraintes géométriques, mais ça va peut-être venir.
Et vous, en retour, qu’est-ce que vous avez pris de l’Oulipo ?
J’ai appris énormément de choses à l’Oulipo. Bien plus que je ne pourrais dire. J’ai beaucoup utilisé, en particulier, tout ce qui tourne autour des sextines.
Qu’est-ce que c’est ?
La sextine est une forme poétique qui a été inventée il y a très longtemps par un troubadour nommé Arnaut Daniel. C’est un poème de six strophes de six vers. Il n’y a pas de rimes, mais il y a des « mots- rimes ». Ce sont les mots qui terminent les vers de la première strophe. On les permute et ces mêmes mots, dans un nouvel ordre, sont ceux qui terminent les vers de la deuxième strophe. Et ainsi de suite. Il y a d’autres contraintes, mais je vais me limiter à celle-ci.
La permutation qu’on utilise, si on la fait une sixième fois, on revient au point de départ. C’est pourquoi on s’arrête à six strophes.
On peut aussi utiliser cette permutation pour écrire de la prose. Pas pour permuter des « mots-rimes », mais des thèmes.
Ce sera plus clair avec un exemple. Quand j’ai écrit Une vie brève, j’avais très peu d’informations, donc très peu de matériaux, et je voulais absolument ne rien laisser se perdre. J’ai tout rangé dans des cases : les lieux, la famille, les mathématiques, etc. Ensuite, j’ai tout ordonné de façon chronologique. Les six strophes du poème, ici les chapitres du livre, sont six dates, six périodes différentes. Et chacune énumère ce que je sais de ce moment sur chacun des six thèmes choisis.
J’ajoute que cette permutation fait que le dernier « mot-rime » d’une strophe est le premier de la strophe suivante. Dans l’exemple de la prose, cela crée une sorte de continuité d’un chapitre au suivant.
Une vie brève a été écrit avec une sextine ?
Ça ne se voit pas trop, mais oui. Le chapitre 0 ne compte pas, c’est l’apport de l’éditeur. Mais après, il y a six chapitres (Avant / Béjà, 14 février 1932 / Déplacements / Alger / 1957 / Après), qui sont tous divisés en six parties. Dans ce cas, c’était six mais on peut le faire avec d’autres nombres.
Dans Cent vingt et un jours , c’est à peu près la même idée, mais c’est avec le nombre onze (une onzine). Dans Comme une rivière bleue, j’ai utilisé ça autrement. Dans la scène du bal, il y a onze femmes qui dansent et qui changent de partenaire à chaque danse. Ça tourne comme dans une danse. Dans ce cas, je trouve que c’était bien adapté parce que ça tourbillonne, du fait d’utiliser toujours la même permutation. Même si les lecteurs ne savent pas comment ça a été écrit, ça se ressent.
On reviendra plus longuement sur les contraintes, continuons sur Une vie brève. Dès le départ vous dites que ce n’est pas un livre sur « l’affaire Audin », que pour vous cette affaire, c’est d’abord une affaire personnelle.
Le problème c’est qu’on ne parle jamais de mon père si ce n’est pour dire qu’il est mort, qu’il a disparu… il y a effectivement un côté « affaire privée » dans cette histoire-là mais ça semblait n’intéresser personne. Quand j’ai écrit ce livre, c’était déjà beaucoup trop tard. Mes grands- parents étaient morts, ils ne pouvaient pas raconter. Ma mère ne parlait pas beaucoup. Je manquais un peu de sources. Il y avait peu de choses. J’ai recherché des traces que j’ai utilisées comme j’ai pu. Et finalement, j’ai réussi à écrire quelque chose sur la vie.
En écrivant le livre, vous vous rendez compte qu’il vous suffit par exemple d’imaginer votre père en train de monter la rue de la Sorbonne et de l’écrire, pour que cela devienne un souvenir (même s’il n’a jamais existé).
Une des choses que j’ai apprises en écrivant ce livre c’est que les traces peuvent produire, peut-être pas des souvenirs, mais du texte, de la narration, une histoire. Par exemple, un carnet de comptes, c’est tout sauf de la littérature. Tant qu’on n’a pas écrit.
Mais oui, bien sûr, j’ai beaucoup réfléchi à ce qu’étaient les souvenirs.
Ça rappelle beaucoup Georges Perec.
J’ai utilisé pas mal de choses venant, d’une façon ou d’une autre, de Perec.
De quelle façon ?
Pour raconter l’enfance de mon père, j’ai utilisé les souvenirs de ma tante Charlye, sa grande sœur. Elle a écrit ses souvenirs d’enfance. C’est là que j’ai appris des choses sur mon père allant à l’école, ce qu’il lisait, Sans famille, L’île mystérieuse, etc.
Mais je pose aussi des questions, comme: «est-ce qu’il jouait au barbu ? » dont plusieurs m’ont été inspirées par Je me souviens de Georges Perec.
Ça c’est des clins d’œil, mais je me demande de quelle façon la lecture de Perec vous a aidé à écrire ?
Dans W ou le souvenir d’enfance, Perec dit : « Je n’ai pas de souvenir d’enfance. » J’ai beaucoup réfléchi à ça. Si je pense à mes souvenirs d’enfance, la plupart sont des choses dont ma mère m’a parlé, qu’elle m’a rappelées, quand j’étais encore enfant. Mon frère Pierre, qui n’avait qu’un mois quand notre père est mort, m’a dit n’avoir aucun souvenir d’enfance. Ma mère n’a pas pu lui dire : « Tu te souviens, avec ton père, tu faisais ci, ou ça… »
Je crois que le « pas de souvenir d’enfance » de Perec, c’est exactement ça : ses deux parents ont été tués, il n’a eu personne pour lui parler. J’ai l’impression que beaucoup de nos souvenirs d’enfance sont fabriqués avec ce que nous ont dit d’autres témoins. Et j’ai aussi le sentiment qu’une fois que vous avez écrit quelque chose, cela se fige. Ainsi, comme je l’ai écrit dans Une vie brève, il y a des choses dont je pense me souvenir et que j’ai préféré ne pas écrire.
Pour les préserver ?
Oui.
Concernant votre mémoire, vous constatez qu’il y a deux disparitions. L’une positive : la colonisation. L’autre négative : la disparition du monde où vivait votre famille, d’autant plus que vous rejetez très fortement « la nostalgie pied-noir ».
Je ne sais pas si c’est complètement négatif.
Qu’est-ce que je me suis fait engueuler à cause de cette histoire de nostalgie « pied-noir » ! (rire). Mais je maintiens ! Par exemple, dans cette « nostalgie pied-noir », il y a le dernier regard sur Alger, jeté à partir du bateau, en 1962. Eh bien, nous, on est partis en 1966 et en train !
Alger aujourd’hui s’est beaucoup transformée, ce n’est plus du tout la même ville. Ce ne sont plus les mêmes gens, ni les mêmes endroits. On n’a pas à avoir de la nostalgie pour ça, on voulait que ça disparaisse, ça a disparu, c’est tout.
Pourtant, il y a un ancrage qui s’est perdu pour vous.
Ah ben, ça a disparu, et ce n’est plus mon pays, c’est sûr. Nous, on n’y est plus.
Ça c’est un problème aussi. Mais ce n’était pas tellement le lieu d’aborder ça, dans Une vie brève.
Vous mentionnez qu’il y a chez vous une envie de vous raccrocher à une histoire collective qui vous échappe.
Ah oui, c’est sûr. J’ai quand même été élevée dans ce qu’on a appelé « un rêve algérien ». On était tous là, ça allait être notre pays. Et puis ce n’était pas vrai. Ça n’a pas marché (rire).
Ça n’a pas été très facile, j’ai eu un peu de mal à changer de pays (dans ma tête).
Du coup, vous allez la chercher ailleurs, cette envie de vous raccrocher à une histoire collective…
Dans l’histoire de la Commune de Paris, par exemple. Et l’histoire des femmes, en général.
Vous êtes aussi très attentive au sort subi par les Juifs durant la seconde guerre mondiale…
Pour ce qui est de la Shoah, c’est une sorte de destin collectif. Alors que j’ai ressenti très fortement, arrivée en France, que nous, nous étions vraiment seuls de notre espèce. Oui, c’est peut-être une façon de se raccrocher à quelque chose.
Dans Une vie brève, derrière l’objectivité apparente du texte, l’émotion affleure par les trous, les moments où vous dites qu’il vous manque quelque chose. Est-ce une forme de pudeur ?
Oui. Face à l’expression de la douleur.
Votre vocation de mathématicienne, on la lie tout de suite à votre père. Et pourtant…
J’ai été obligée d’expliquer des dizaines de fois qu’il n’y a rien de génétique là-dedans. J’ai fait des maths avec ma mère quand j’étais petite. Ma mère était prof de maths. Et puis, comme j’ai dit, elle ne parlait pas beaucoup, donc les maths c’était bien, on pouvait parler sans difficulté. Vraiment, c’est elle qui m’a donné le goût des mathématiques, il n’y a aucun doute là-dessus.
À propos de mathématiques, il y a un livre dont on ne vous parle pas beaucoup, c’est La formule de Stokes, roman.
C’est un livre que j’ai écrit plus ou moins en même temps que Cent vingt et un jours. Un livre dont l’héroïne est une formule de mathématiques : la formule de Stokes. C’est un roman historique. Et c’est un livre assez contraint dans sa forme, puisque les histoires sont rangées par ordre de date, comme s’il y avait une seule année, mais pas par ordre chronologique, donc il peut y avoir des histoires qui se suivent sans s’être passées dans cet ordre-là.
C’est une formule de mathématiques que je trouve très belle, qui n’est pas très facile à expliquer pour les gens qui n’ont pas fait de mathématiques mais qui a quand même une belle histoire. Il y a beaucoup de mathématiciennes et mathématiciens qui ont contribué à cette formule, leur histoire est intéressante.
Il y a chez vous, une envie de vulgarisation des mathématiques.
Il y a une envie de popularisation de tout. L’histoire, les mathématiques… Un enjeu démocratique !
En ce qui vous concerne, l’envie ou le besoin de passer par des contraintes pour écrire, est-il lié aux mathématiques ?
Oui. Je pense qu’en littérature le jeu entre la rigueur et l’imagination est du même ordre qu’en mathématiques. Je vais donner un exemple. Au milieu de soixante autres personnes, j’ai travaillé de loin avec un poète américain qui s’appelle Guy Bennett qui a fait des « poèmes sur instruction ». Il a donc envoyé des instructions, quatre-vingt-dix- neuf je crois, à une cinquantaine ou soixantaine de personnes. On pouvait choisirlesinstructionsetécriredespoèmes.Unedesinstructionsétait : écrire un poème qui n’emploie pas deux fois le même mot. On pouvait poser des questions, donc j’ai posé une question de mathématicienne : par « deux fois », vous voulez dire, « exactement deux fois » ? Et j’envoie une réponse de mathématicienne, qui est :
une fois
deux fois
trois fois.
Il me dit : « Very clever ». C’est un Américain, mais très bon francophone. C’était flatteur, mais je crois que c’était surtout oulipien. Voyez mon ami Paul Fournel, qui n’est absolument pas mathématicien et qui est un écrivain de l’Oulipo. Lui, il prend une autre instruction qui était : écrire un poème qui se voile la face. C’est des instructions, c’est pas des contraintes. Il répond :
Point de vue.
C’est aussi « very clever ». Il y a aussi un côté rigueur et minimalité qui est proche des mathématiques.
Si vous faites de la recherche en mathématiques, que vous voulez démontrer un nouveau théorème, il faut d’abord que le théorème soit bien énoncé, de façon claire, nette, quasiment non paraphrasable. Et puis il faut écrire une démonstration qui soit assez limpide pour convaincre les autres. C’est assez proche, vous voyez.
Il y a une chose qui revient souvent dans vos livres, c’est la fragmentation, de façon à ce que si j’essaye de résumer Cent vingt et un jours par exemple, j’aurais beaucoup de mal à le faire. Le recours aux contraintes n’est-il pas aussi une façon de structurer vos matériaux ?
Oui, et il y a aussi une volonté d’épuiser le réel.
Par exemple, dans Comme une rivière bleue, il y a un chapitre qui se passe chez les Marx, à Londres, dans lequel Jenny (la fille de Marx) aimerait comprendre ce qui se passe exactement à Paris. Le chapitre suivant décrit Paris de façon très précise du lever au coucher du soleil. C’est aussi fait avec une sextine. L’idée c’est vraiment d’épuiser tout ce qu’on peut savoir de ce qui s’est passé ce jour-là, en utilisant les journaux, les faits divers, l’état civil, le calendrier, la météo, la lune, etc. C’est forcément fragmenté, si on veut décrire tout ça.
Ça ressemble à un montage.
Oui.
Dans Cent vingt et un jours, celui qui nous donne à voir le montage des matériaux, le narrateur, est un historien. Pourtant, le livre commence par un conte.
Oui, le premier chapitre est un pastiche d’un conte de Kipling, L’Enfant d’Éléphant (Histoires comme ça). Et le narrateur raconte l’histoire à sa fille.
Vous dites que tout est vrai (en citant Balzac), mais vous précisez que c’est une fiction. Est-ce que ça vient d’une idée que vous avez de l’Histoire ou avez-vous dû jongler avec des faits réels ?
Je ne sais pas si j’ai une idée de l’Histoire. À l’époque où j’ai écrit ce livre, je ne connaissais pas grand-chose à l’Histoire. Je découvrais un certain nombre de techniques.
Le livre est composé comme ça : un chapitre basé sur une photo, un autre sur ce que raconte un personnage, puis le journal de l’Allemand (un nazi)…Chaque chapitre a une facette qui est un matériau de l’histoire. J’ai essayé d’en faire le tour. La fiction, le conte au début, puis les articles de journaux…C’était plutôt ça. Je ne pense pas que j’avais une vision de l’Histoire, mais je me demandais : qu’est-ce qu’utilise un historien ? Qu’est-ce qu’il y a dans les archives ? Des photos, des journaux intimes… Il y a aussi le journal de l’Allemand, qui est un papier publié, plus formel, qui imite un document d’archives et ressemble plus à ce que je voulais faire au départ. Ce dont je vous ai parlé au début de l’entretien : publier la correspondance entre ces deux mathématiciens, le Français collabo et l’Allemand nazi. Ils s’écrivent très régulièrement, et en français. L’Allemand a tout conservé, il était à Göttingen, qui n’a pas été bombardée. On peut lire ces archives. On pourrait même les publier si les ayants droits étaient d’accord. Les ayants droits de l’Allemand n’ont rien contre. Ceux du Français si. Je faisais ça avec un collègue, un historien des maths. Il m’a dit : « qu’est-ce qu’on fait ? » J’ai dit : « je vais écrire un roman ».
Votre narrateur, l’historien, ne veut pas faire de hiérarchie entre les faits privés et les évènements historiques.
Oui, ça fonctionne ensemble.
Ça fait écho au fait de vouloir raconter des choses qui relèvent plus de la vie des gens que des évènements en eux-mêmes.
C’est ce que dit Camus, la citation que j’ai mise en exergue d’Une vie brève : « Le rôle de l’écrivain…ne se sépare pas de devoirs difficiles. Par définition, il ne peut se mettre aujourd’hui au service de ceux qui font l’histoire : il est au service de ceux qui la subissent. »
C’est ce qui m’intéresse. Ceux qui n’ont pas d’histoire, ceux qui la subissent. Ceux dont on ne parle pas. Des gens comme mes grands- parents. Typiquement des gens qui n’ont pas d’histoire.
L’oubli est un thème qui revient souvent dans vos livres.
L’oubli au sens où ce sont des personnes qu’on a oubliées. En travaillant sur la Commune de Paris, je découvre chaque jour encore une femme qui a été omise. Elles l’ont toutes été. Et elles continuent à l’être par les historiens jusqu’à maintenant. C’est impressionnant. Chaque jour, je peux en trouver une qui a fait quelque chose d’intéressant et qu’on a gommée, oubliée. Dans Mademoiselle Haas, c’est ce que je dis au début, elles sont omises. Elles sont toutes comme ça, dans ce livre-là.
Est-ce pour par un souci de rééquilibrage que dans Comme une rivière bleue, il y a une absence du point de vue des écrivains célèbres de cette époque, sauf une mention de Daudet qui en parle comme « Paris au pouvoir des nègres » ?
Dans Comme une rivière bleue,il y a un personnage qui s’appelle Kadour, un Algérien. Celui-là, il vient de Daudet. J’en avais beaucoup contre Daudet, à cause d’une nouvelle qui s’appelle Le Turco de la Commune et qui m’a scandalisée. C’est l’histoire d’un petit gars qui est venu de Médéa, on l’a embarqué comme ça, on l’a envoyé faire la guerre contre la Prusse. Puis il s’est retrouvé à Paris. Il est là avec son fusil, il ne sait pas ce qui se passe, mais il voit que les gens tirent, donc il sort avec son fusil et il tire. C’est un abruti, il ne comprend rien à ce qui se passe et puis il se fait tuer… Je ne sais plus s’il s’appelle Kadour dans la nouvelle. En signe de protestation, je l’ai pris, je l’ai mis dans le livre et j’en ai fait un personnage à part entière. Qui se bat pour la Commune, en toute conscience.
Sinon, je crois que je cite Goncourt qui va à Belleville, après la fin de la Commune. Et il dit : « Ils sont vaincus mais ils ne sont pas soumis. » Ce qui est tout à fait exact.
Est-ce la même idée lorsque le narrateur insiste pour faire un parallèle entre la brutalité de la police vis-à-vis des communards et celle vis-à-vis des « indigènes » durant l’Algérie coloniale ?
Ce n’est pas vraiment la police, c’est l’armée. À laquelle les pouvoirs de police ont été donnés. À l’échelle d’une grande ville comme Paris, c’était une belle invention. Évidemment, ce «scénario» évoque la bataille d’Alger. Le parallèle s’impose. D’autant plus que la façon dont les journalistes et les politiques parlaient, à l’époque, je veux dire 1871, de la population ouvrière parisienne m’a rappelé la façon dont on parlait des « indigènes » à Alger, quand j’étais petite (ils sont petits, chétifs, sales, voleurs… je vous laisse compléter).
Dans ce livre, les personnages qui vivent en 1871, n’ont pas conscience qu’ils sont en train de faire la Commune.
Non, pas tous. Ils sont contents, ils font la fête, puis ils veulent changer le monde peut-être et puis ils se font tuer.
Alors qu’en parallèle, le narrateur au présent, je veux dire celui qui parle à partir d’aujourd’hui, est en train de décrire cette histoire et il réfléchit dessus.
La première chose qu’il dit c’est qu’il y a eu beaucoup de disparitions. On ne sait même pas combien. La femme à qui il dit ça, lui demande : « Qu’est-ce que ça veut dire disparaître ? » Bonne question (rire).
Alors, je vous pose la question à vous : qu’est-ce que ça veut dire disparaître ?
Difficile question pour une fille de disparu. Il y a une définition légale. Pas d’acte de décès. Pour certains, au bout d’un certain temps, un jugement les déclarant morts et sa transcription à l’Etat-civil. Dans le cas des disparus de la guerre d’Algérie, je suppose que cela a été rarissime.
Je cite le narrateur : « La Commune. Pourquoi en parler ? Évènement du dix-neuvième siècle, mythe du vingtième, ai-je lu quelque part. Et quoi du vingt et unième ? »
Le monde dans lequel nous vivons (en France) est exactement « la République versaillaise ». Ce qui se passe en 1871 et qui est très original, c’est que ces gens-là, on ne leur a jamais demandé leur avis, on les a même en général empêchés de le donner. Et là, ils prennent le pouvoir, et ils décident de faire des choses. Et puis, c’est très démocratique, on discute de tas de choses partout. Dans tous les coins, il y a des gens qui discutent. Par exemple, les femmes, elles ne votent pas, elles ne demandent pas à voter, elles ne sont pas élues… et pourtant elles participent. Ça, ça veut dire que la démocratie, ce n’est pas juste élire des gens qui vont faire des trucs à votre place pendant cinq ans. Ça le prouve amplement. Aujourd’hui, pourtant, on vit dans une République où la démocratie c’est ça. On élit quelqu’un pour cinq ans et puis on n’en parle plus. C’est en ce sens-là que c’est actuel de parler de la Commune. Qu’il faut en parler, raconter, expliquer ça maintenant. Évidemment, je ne peux rien contre la propagande de droite, d’extrême droite, mais bon, on peut au moins essayer.
Le premier mai 2016, vous commencez à tenir un blog sur la Commune, qui continue encore à être alimenté.
Mille cent articles à ce jour. Avec un article tous les quatre jours, j’ai encore de quoi l’alimenter jusqu’à octobre de l’année prochaine. De temps en temps, je me dis, maintenant ça va s’arrêter puis je trouve un truc nouveau. Quelque chose dont personne ne parle.
Au début, c’était pour écrire Comme une rivière bleue ?
Quand j’ai voulu écrireComme une rivière bleue, j’ai beaucoup lu, beaucoup appris. Et puis je savais tellement de choses…je savais trop de choses pour écrire un roman, ça me gênait. Je me suis dit : « que faire » ? J’ai alors ouvert ce blog. Je voulais publier trois ou quatre trucs, m’en débarrasser pour pouvoir écrire le roman. C’est ce qui s’est passé… sauf que le blog a pris son autonomie et a continué. J’ai fait les deux.
Comment faire le choix parmi ces matériaux pour resserrer sur un livre ?
En fait, ce qui m’avait le plus énervé c’est que j’avais lu tellement de choses fausses. Impossible d’écrire un roman avec une liste d’âneries écrites par d’autres. Mais comme je suis un peu psychorigide, je ne pouvais pas ne pas en parler. J’ai mis ça dans le blog, qui a été une sorte de « trop plein ». Mais on n’a pas parlé de Josée Meunier, 19, rue des Juifs qui est mon livre préféré !
Parlons-en. J’ai l’impression que c’est votre roman le plus romanesque.
Dans quel sens ?
Dans le sens où votre narrateur réflexif s’efface devant l’histoire des personnages, même s’il y a le personnage de Georgette…
Oui, Georgette avait très envie d’écrire le livre (rire).
Josée Meunier est un roman d’amour. J’avais toujours rêvé d’écrire un roman d’amour.
C’est une ouvrière parisienne qui aide un communard, Albert Theisz, à se cacher puis à quitter Paris après la Semaine sanglante. Puis elle le rejoint à Londres. On sait, grâce à un mouchard, qu’il a été soutenu à Londres par une blanchisseuse. Mais on ne sait rien de plus d’elle, même pas son nom. Personne n’a rien fait, à l’époque, pour qu’on en parle. Elle a été omise.
Elle est l’héroïne du roman.
Qu’en est-il des archives ?
Il n’y a que ce rapport de mouchard. Vous vous rendez compte ! C’est une ouvrière, elle n’est jamais sortie des fortifications de Paris, elle prend le train, elle va en Angleterre, elle arrive à Londres comme ça… elle n’a pas appris l’anglais à l’école, ce n’est pas aujourd’hui que ça se passe ! Elle quitte son mari, elle va rejoindre son amoureux, et personne ne sait qui elle est. Enfin, maintenant elle existe, grâce au livre (rire).
Est-ce que la fiction pour vous, c’est ce qui comble les trous dans les archives ?
Oui ! Dans ce livre c’est clair. Cette idée, je l’ai ébauchée dans Oublier Clémence.
J’avais cherché des informations sur cette femme, Clémence Janet, une ouvrière en soie morte à l’âge de vingt et un ans, pendant que j’écrivais Une vie brève. C’est exactement une femme qui n’a pas d’histoire, si ce n’est dans l’état-civil. Ce n’est pas une disparue, elle a un acte de naissance, un acte de mariage, un acte de décès. Mais on ne sait rien d’elle. Je crois être allée aussi loin que je pouvais sans ajouter de fiction.
Une autre femme, Maria Verdure, est une des héroïnes de Comme une rivière bleue. Je me disais, j’invente une histoire d’amour pour cette femme qui a vraiment existé. Mais tout le monde va m’écrire, mais non, c’est pas comme ça que ça s’est passé. Pourtant, personne ne sait rien d’elle. Enfin, elle, au moins, on connaît son nom.
Et comment faites-vous pour vous documenter sur la vie quotidienne des ouvriers ? Ce qu’ils se disent, ce qu’ils mangent, les objets qu’ils utilisent…
Les objets, oui, c’est pour ça que j’ai commencé Josée Meunier par un inventaire. J’ai essayé de comprendre ce qu’il y avait dans les maisons des personnages. Pour se documenter, c’est simple : il suffit de lire des livres de l’époque et puis vous imaginez. Ça tombe bien : j’aime beaucoup les romans du dix-neuvième siècle. Malheureusement, très peu de livres se passent dans ces milieux-là… Dans ce cas-là, j’avais une description très précise de l’immeuble, que j’avais lue aux archives.
Vous y êtes allée ?
Ça a commencé comme ça. Je vais aux archives de la Préfecture de police. Je cherche des choses sur Adolphe Clémence, un communard relieur. Il a un dossier. Je l’ouvre. Je vois qu’il y a ce flic, Berlioz, qui est allé perquisitionner son immeuble, à sa recherche. Et il dit : « Cet immeuble est un vrai labyrinthe. » Il dit aussi que la concierge est la tante d’un communard (donc suspecte). Je regarde l’immeuble en question (l’adresse a changé mais pas l’immeuble). C’est un petit immeuble carré. Ça je suis allée le voir aux archives de Paris. Ensuite, j’y suis allée. Il y a un digicode, mais on réussit quand même à entrer. Je suis montée dans les étages. Ça n’a rien d’un labyrinthe. Donc, je me dis que la concierge l’a mené par le bout du nez. Elle s’est foutue de lui ! Je vais écrire un livre avec ça.
La seule chose que je savais sur l’endroit où s’était caché Albert Theisz, c’est que c’était quelque part dans le Marais, qui est le quartier où se trouve cet immeuble. Je l’ai collé là-dedans et j’ai écrit l’histoire avec ça.
Il vous arrive aussi d’omettre des choses sciemment. Par exemple, Manet n’est pas mentionné dans Comme une rivière bleue, sauf comme étant « le peintre ».
Il y a un peintre dans ce livre, mais il n’est pas nommé. C’est vous qui pensez avoir reconnu Manet !
On a un déroulé très précis de l’emploi du temps d’Édouard Manet en 1871. Il est à Arcachon, il monte à Paris. Il a fait deux lithographies pendant la Commune, dont une clairement près de la Madeleine, pendant la Semaine sanglante. Il y a une lettre qui dit qu’il était là pendant la Semaine sanglante, mais la lettre est datée du 5 juin, et elle n’est pas de lui. Donc on préfère croire qu’elle ne veut rien dire. J’écris donc à des historiens de l’art pour leur demander, des spécialistes. Il y a un trou là. Quand est-ce qu’il arrive ? On ne me répond pas. Ou alors, « … mais ne dites pas que vous m’avez posé la question… » Sans commentaire. Il semble qu’il était là, mais qu’on n’a pas le droit de le dire…
Pourquoi est-ce autant un tabou ?
Parce que ces messieurs ne veulent pas entendre parler de la Commune.
Mais revenons à Manet. Il a peint un tableau qui s’appelle L’explosion, qui est dans un musée à Essen, en Allemagne. Ce tableau ne figure pas dans le catalogue officiel des œuvres de Manet. Encore une disparition. Il y a une théorie qui consiste à dire que ce tableau n’est pas de Manet. Et on me dit : « Ne dites pas que vous m’avez posé la question. » Bon, puisque c’est comme ça, j’ai décidé que je n’allais pas citer le peintre. Mais à la fin du livre, dans le dernier chapitre, le peintre apparait à l’endroit précis où il aurait été s’il s’était appelé Édouard Manet.
Pourquoi ne pas l’avoir mentionné dans le livre ?
Pourquoi le ferais-je ? Je ne suis pas historienne de l’art. J’écris un roman.
Josée Meunier a besoin de moi pour exister, pas Manet.
Finalement, ce n’est que dans votre dernier livre paru,Paris, boulevard Voltaire, que vous parlez en votre nom propre sans passer par la distance des archives.
C’est ce que vous croyez !… Mais pas du tout !
Je raconte un certain nombre d’histoires qui se passent au long du boulevard Voltaire, à Paris. L’une d’elle est consacrée à un cinéma qui se trouvait sur ce boulevard, assez longtemps et en particulier dans les années 1980. Elle est écrite à la première personne du singulier, et « je » raconte « ma » vie dans ce cinéma en 1982, d’abord seule puis avec un amoureux. Plusieurs de mes amis ont cru comprendre que je racontais comment j’avais rencontré mon ami.
Ce qui est marrant, c’est que ce n’est pas vrai. C’est une pure fiction. Basée sur des archives… Je suis allée à la Bibliothèque Nationale, j’ai demandé l’Officiel des spectacles (pour août et septembre 1982, ce qui m’a servi d’archives), j’ai regardé les programmes des cinémas dans le onzième arrondissement, et j’ai écrit cette histoire.
J’ai raconté ces retours à mon éditeur, il en était extrêmement joyeux : « Ben c’est là qu’on a gagné, si tout le monde croit que c’est vrai ! »
[1] 1-La Commune de Paris est un mouvement révolutionnaire qui a tenté d’instaurer une république démocratique et sociale, après le siège de Paris par l’armée prussienne et la capitulation en janvier 1871. Le 18 mars, la population parisienne a « pris le pouvoir » et administré la cité avant de s’achever au cours de la Semaine sanglante (21 au 28 mai), un massacre de masse qui a mis fin au mouvement. Celui-ci est un modèle pour les démocrates du monde entier.